C’est reparti pour un tour. La chronologie des médias, qui régit la sortie des nouveaux films après les quatre mois exclusifs des salles de cinéma, doit faire l’objet d’un nouvel accord interprofessionnel qui doit entrer en vigueur en février. Le consommateur connecté reste le grand perdant.
 Un an après la signature – le 24 janvier 2022 – de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France (1), les professionnels du cinéma, de la télévision et des plateformes de vidéo à la demande doivent signer un nouvel accord intégrant des ajustements négociés depuis plus de six mois. Cette nouvelle mouture, élaborée sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), laisse un tout petit peu de place aux plateformes de VOD, d’une part, et de SVOD, d’autre part. Alors que la généralisation des usages numériques aurait justifié d’avoir des nouveaux films plus tôt après leur sortie dans les salles obscures.
Un an après la signature – le 24 janvier 2022 – de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France (1), les professionnels du cinéma, de la télévision et des plateformes de vidéo à la demande doivent signer un nouvel accord intégrant des ajustements négociés depuis plus de six mois. Cette nouvelle mouture, élaborée sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), laisse un tout petit peu de place aux plateformes de VOD, d’une part, et de SVOD, d’autre part. Alors que la généralisation des usages numériques aurait justifié d’avoir des nouveaux films plus tôt après leur sortie dans les salles obscures.
VOD et SVOD : très peu d’avancées
Les deux grands gagnants de cette nouvelle chronologie des médias qui entrera en vigueur en février, sans grands changements par rapport à celle signée l’an dernier, sont les salles de cinéma et la chaîne cryptée Canal+. Les premières, quasiment toutes membres de l’influente Fédération nationale des cinémas français (FNCF) dont le président Richard Patry (photo de gauche) a été encore réélu le 26 janvier, gardent leur monopole sur les quatre premiers mois à compter de la date de sa sortie des films le mercredi. La VOD à l’acte et les DVD/Blu-Ray doivent attendre le cinquième mois après la sortie du film en salle pour pouvoir le proposer. A l’heure du numérique, ce délai est bien trop long et favoriserait le piratage de films sur Internet.
Il y a bien une dérogation possible à trois mois, mais elle est rarement demandée car la condition fixée par décret est très restrictive : actuellement, le film doit avoir réalisé 100.000 entrées au plus – en général moins – à l’issue de sa quatrième semaine d’exploitation en « salles de spectacles cinématographiques » (2). Le Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande (Sévad) a proposé lors des dernières négociations d’étendre la dérogation des trois mois à tous les films qui le souhaitent – sous réserve de l’accord de l’éditeur-distributeur – pour être proposés plus tôt en VOD à l’acte. Mais cela se fera à titre « expérimental ». Les plateformes Orange VOD, Canal VOD, Filmo TV, UniversCiné ou encore Viva by Videofutur pourraient en profiter. Le nouvel accord devrait intégrer cette « fenêtre premium » à trois mois après la salle, moyennant un prix qui serait plus élevé pour le consommateur. C’est dommage pour ce dernier, à l’heure où son pouvoir d’achat est déjà grevé par l’inflation… Ce serait donc un petit pas en avant, mais à des « mois-lumière » de la sortie simultanée salles-VOD (day-and-date) qui reste un tabou en France. Quant à la SVOD, avec ses plateformes emblématiques que sont Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Paramount+ (pour ne citer que celles-ci), elle a déjà avancé il y a un an dans chronologie des médias : passant alors de 36 mois à 17 mois voire à 15 mois en cas d’accord avec les organisations professionnelles du cinéma. « C’est la raison pour laquelle nous l’avons signée. [Mais] ce n’est qu’un premier pas », avait prévenu Damien Bernet, directeur commercial et juridique de Netflix France, devant l’Association des journalistes médias (AJM) fin juin (3).
Restait notamment la question de la continuité d’exploitation d’un film en SVOD lorsque la fenêtre de la télévision en clair s’ouvre. Car jusqu’alors, la chronologie des médias imposait à la plateforme de SVOD de retirer le film lorsque celui-ci commence à être proposé au 22e mois après sa sortie en salle par une chaîne en clair qui l’a préfinancé ou acquis. Autrement dit, un film sur Netflix ou Disney+ devait être retiré du catalogue après cinq ou sept mois de mise en ligne au profit de la fenêtre de la télévision en claire (TF1, M6, France Télévisions) s’ouvrant en exclusivité durant quatorze mois ! Disney avait tapé du poing sur la table en juin 2022 en décidant de ne pas sortir dans les salles de cinéma françaises « Avalonia, l’étrange voyage » mais en exclusivité sur Disney+, provoquant le courroux de la FNCF. Ayant menacé de faire de même avec « Black Panther : Wakanda Forever », The Walt Disney Company avait donné un coup de pression aux négociations en France (4).
Canal+, donnant-donnant avec le cinéma
La nouvelle chronologie des médias devrait finalement prolonger d’au moins deux mois la fenêtre d’exploitation de la SVOD pour de tels films, s’ils sont produits en interne (« inhouse ») avec un budget de plus de 25 millions d’euros. Pour ces films-là, les chaînes gratuites bénéficieraient en échange d’une exclusivité de deux mois. Là aussi, cela se fera à titre « expérimental ». Canal+, la chaîne cryptée qui rachète OCS à Orange, est la grande gagnante avec son positionnement à six mois après la sortie en salle (au lieu de huit avant le 28 janvier 2022). Sur RTL le 11 janvier (5), son président Maxime Saada (photo de droite) – en lice pour « la personnalité de l’année 2022 » du Film Français (6) – s’est engagé à investir sur cinq ans plus de 1 milliard d’euros dans le cinéma français. @
Charles de Laubier

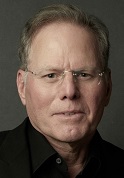


 La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média.
La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média.