En fait. Le 26 mai, la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière, a annoncé sur BFM Business qu’elle allait suggérer à Thierry Breton de prendre des mesures au niveau européen pour faire payer plus les GAFA pour la bande passante qu’ils utilisent. La mesure divise mais elle est poussée par la FFTélécoms.
En clair. « C’est un vieux débat, selon lequel les GAFA doivent payer plus pour le financement des réseaux s’ils occupent la bande passante. C’est un débat qui doit se passer au niveau européen. C’est un débat que j’avais initié il y a une dizaine d’années, alors que j’étais députée, en me disant qu’il ne serait pas finalement illogique de mettre au niveau européen une “terminaison d’appel data”, c’est-à-dire des échanges de financements à l’interconnexion du réseau Internet », a déclaré Laure de La Raudière (LDLR) le 26 mai sur BFM Business. La présidente de l’Arcep est sur la même longueur d’onde que la Fédération française des télécoms (FFTélécoms), laquelle ne cesse de faire des appels du pied au régulateur pour obliger les géants du numérique à payer pour les réseaux qu’ils utilisent mais qu’ils ne financeraient pas – alors qu’en réalité ils ont des accords, lorsqu’ils n’investissent pas eux-mêmes dans leur propre infrastructure. « Tout une partie de la valeur est captée par les GAFA (…). Or, ils n’investissent pas un euro dans les infrastructures. (…) C’est une situation qui ne peut plus durer. (…) Les GAFA pourraient donc contribuer proportionnellement à leur utilisation du réseau », avait par exemple glissé Arthur Dreyfuss, alors président de la FFTélécoms, dans un entretien à Capital il y a près de deux ans (1). Il se trouve que le secrétaire général d’Altice France/SFR a repris (2) les fonctions de président de la fédération (dont n’est pas membre Free) depuis le 1er juin 2021, pour un mandat d’un an. Si LDLR et Arthur Dreyfuss semblent s’être donnés le mot, l’approche du régulateur est plus européenne. « Je pense que ce n’est pas envisageable au niveau français, a précisé la présidente de l’Arcep, parce qu’il y aurait des effets d’éviction [de contournement, ndlr] extrêmement simple (3). Au niveau européen, je l’ai souhaité (que les GAFAM contribuent pour la bande passante) ; je l’ai porté (ce débat) en son temps et je continuerai à le porter ».
Et d’ajouter : « Pour l’instant, il n’y a pas unanimité sur ce point de vue que j’exposerai à Thierry Breton [commissaire européen au Marché intérieur, ndlr] » (4). Il y a dix ans, alors députée, LDLR – et sa collègue Corinne Ehrel – avait mené « une réflexion sur une “terminaison data” pour financer la congestion des réseaux » dans le cadre d’un rapport sur la neutralité de l’Internet (5). Orange, SFR ou encore Colt militent pour (6). @
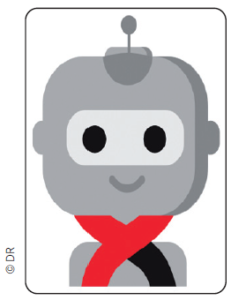 Les chatbots s’en donnent à cœur-joie. A part la Californie qui leur a consacré une loi en 2018 pour les encadrer et assurer une transparence vis-à-vis des utilisateurs et des consommateurs (1), aucun autre pays – ni même l’Europe pourtant soucieuse du droit des consommateurs et du respect des données personnelles – n’a encore établi de cadre pour réguler ces agents conversationnels aux allures d’êtres humains, qu’il s’agisse d’avatars de l’écrit ou du vocal s’exprimant en langage naturel.
Les chatbots s’en donnent à cœur-joie. A part la Californie qui leur a consacré une loi en 2018 pour les encadrer et assurer une transparence vis-à-vis des utilisateurs et des consommateurs (1), aucun autre pays – ni même l’Europe pourtant soucieuse du droit des consommateurs et du respect des données personnelles – n’a encore établi de cadre pour réguler ces agents conversationnels aux allures d’êtres humains, qu’il s’agisse d’avatars de l’écrit ou du vocal s’exprimant en langage naturel.
 En France, d’après Médiamétrie, Snapchat compte 24,9 millions de visiteurs uniques rien que sur avril 2021, en par hausse de 2,6 % par rapport au moins précédent. L’Hexagone pèse donc à peine 5 % de l’audience mondiale de 500 millions d’utilisateurs mensuels, nombre revendiqué le 20 mai par la « camera company » américaine Snap qui fêtera ses dix ans d’existence cet été. C’est d’ailleurs la première fois que son cofondateur Evan Spiegel (photo) livre une audience mensuelle, s’étant contenté auparavant à mentionner de temps en temps le nombre quotidien de « snapchatteurs » dans le monde : 280.000 au premier trimestre 2021, contre 229 millions un an plus tôt.
En France, d’après Médiamétrie, Snapchat compte 24,9 millions de visiteurs uniques rien que sur avril 2021, en par hausse de 2,6 % par rapport au moins précédent. L’Hexagone pèse donc à peine 5 % de l’audience mondiale de 500 millions d’utilisateurs mensuels, nombre revendiqué le 20 mai par la « camera company » américaine Snap qui fêtera ses dix ans d’existence cet été. C’est d’ailleurs la première fois que son cofondateur Evan Spiegel (photo) livre une audience mensuelle, s’étant contenté auparavant à mentionner de temps en temps le nombre quotidien de « snapchatteurs » dans le monde : 280.000 au premier trimestre 2021, contre 229 millions un an plus tôt. « Nous ne connaissons pas l’étape de la procédure, mais nous savons que le plaignant [en fait plusieurs plaintes de Français épaulés par Noyb, ndlr] a reçu une confirmation de réception le jour du dépôt et il a reçu un autre courriel le 9 avril confirmant que la plainte avait été attribuée au “service des plaintes de la Cnil (
« Nous ne connaissons pas l’étape de la procédure, mais nous savons que le plaignant [en fait plusieurs plaintes de Français épaulés par Noyb, ndlr] a reçu une confirmation de réception le jour du dépôt et il a reçu un autre courriel le 9 avril confirmant que la plainte avait été attribuée au “service des plaintes de la Cnil (