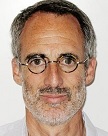En fait. Le 25 avril, lors de l’assemblée générale de Vivendi à L’Olympia, les actionnaires ont voté à 82 % des suffrages exprimés pour la reconduction pour quatre ans de Vincent Bolloré comme administrateur du conseil de surveillance du groupe qu’il préside depuis 2014. Mais pour quelle stratégie ?
En clair. La stratégie du conglomérat français Vivendi n’est finalement pas plus claire depuis que Vincent Bolloré a succédé, il y a près de trois ans, à Jean-René Fourtou
à la présidence de son conseil de surveillance. Pourtant, l’homme d’affaire breton, devenu actionnaire de référence de Vivendi (20,6 % du capital et 29 % des droits
de vote), a été renouvelé comme administrateur pour une durée de quatre années. Certes, le groupe coté du bas de la liste du CAC 40 s’est bien délesté de ses activités télécoms (SFR, Maroc Telecom et GVT) avec l’ambition de devenir « un groupe mondial, champion français des médias et des contenus ».
Mais sa stratégie reste encore floue (1) en termes de développements en Europe (participations dans Telecom Italia, Mediaset, Telefonica) et d’acquisitions réalisées (Gameloft, Dailymotion, …) ou futures (Ubisoft, Havas, …). Il y a un an, Vincent Bolloré avait par exemple annoncé « un partenariat stratégique et industriel » avec l’italien Mediaset (groupe Berlusconi) – dont Vivendi détient 28,8 % du capital – en vue de lancer notamment une plateforme de SVOD en Europe, un « Netflix latin » pour concurrencer le numéro un mondial américain. Mais Vivendi et Mediaset sont aujourd’hui en conflit ouvert. De plus, reconduit par 82 % des actionnaires, le milliardaire et dixième fortune de France (patrimoine de 7,3 milliards d’euros en 2016, selon Challenges) renforce son emprise familiale sur Vivendi où son fils Yannick Bolloré a été – après « cooptation » l’an dernier – élu à 71 % membre du même conseil de surveillance. Et voilà qu’il est question d’un « rapprochement à terme » avec le groupe publicitaire Havas, dont le fils Bolloré est PDG depuis 2013. Havas est contrôlé par le groupe Bolloré (2) et des passerelles existent déjà : le président de Vivendi Content et de Studio+, Dominique Delport, est le numéro deux d’Havas et membre non indépendant du conseil d’administration de Vivendi. Reste à savoir aussi ce qu’il adviendra de Canal+ fragilisé par la fuite d’un demi-million d’abonnés. Le PDG d’Orange avait manifesté en décembre un intérêt en cas de cession de la chaîne cryptée. Pour l’heure, les deux groupes négocient un partenariat commercial. Quant à la major Universal Music, valorisée jusqu’à 20 milliards d’euros, elle fait l’objet de spéculations sur son éventuelle cession – ce que Vincent Bolloré a écarté. @