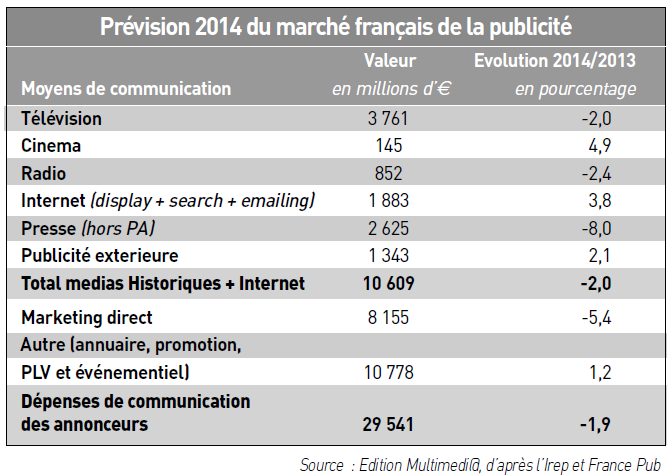En fait. Le 24 novembre 2014, Coca-Cola a annoncé un accord publicitaire et marketing avec Facebook, qui devient le premier partenaire digital de la marque aux sodas en France. Le 20 novembre, au DigiWorld Summit, Laurent Solly, DG de Facebook France a présenté « la vidéo automatique » sur mobile comme la solution publicitaire.
En clair. « Facebook devient une très grande plateforme vidéo », a lancé Laurent
Solly, directeur général de Facebook France le 20 novembre, lors du DigiWorld Summit organisé par l’Idate à Montpellier. Il en veut pour preuve l’audience massive générée
il y a quelques jours par une bande-annonce publicitaire de « Fast and Furious 7 »,
des studios Universal (1), lesquels ont utilisé aux Etats-Unis la nouvelle offre de vidéo publicitaire non intrusive lancée par Facebook au printemps dernier (2). « En 48 heures, il y a eu 100 millions de vues sur Facebook et… 18 millions sur YouTube ! », s’est-il félicité. Coca-Cola pourrait devenir le premier annonceur vidéo de Facebook. La firme de Mark Mark Zuckerberg attend beaucoup de ce nouvel outil vidéo pour monétiser son réseau social, lequel génère déjà deux-tiers de ses revenus grâce aux mobiles. Il s’agit de publicités vidéo en lecture automatique, personnalisée, dans le fil d’actualité (3).
« En tant qu’utilisateur, vous n’ête pas contraints : vous êtes libre de voir le message publicitaire ou de le passer. En aucun cas votre expérience personnelle est interrom-pue : la vidéo se met en route automatiquement et si vous voulez écouter le son, vous cliquez en une touche. Pour les marques, les éditeurs et les médias, c’est un outil extrêmement puissant et qualitatif », a assuré Laurent Solly. Le risque de décevoir
les clients et les prospects ou d’être contreproductif serait considérablement réduit.
« Le modèle d’interruption publicitaire créé au XXe siècle n’est plus adapté à la consommation sur mobile. L’espace s’est réduit ; c’est un espace personnel : il fallait donc inventer un autre modèle économique », a-t-il poursuivi.