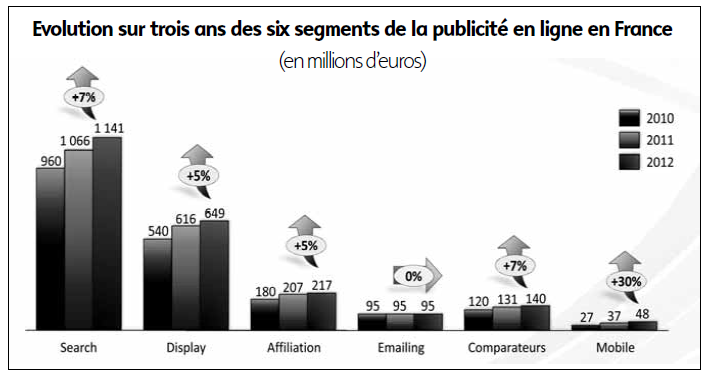Ma première rencontre avec Internet des animaux se
Ma première rencontre avec Internet des animaux se
situe précisément en 2013, lorsque notre vétérinaire équipa notre nouveau chaton d’un système de géolocalisation !
Pour 30 euros, il se proposait d’implanter une micro-puce sous-cutanée permettant de le repérer en cas de disparition soudaine… Je pris alors conscience que l’humanité venait d’embarquer les animaux avec elle, dans ce nouvel arche
de Noé numérique. Bien sûr, cela faisait déjà longtemps
que les scientifiques se servaient de cette technologie pour suivre les migrations des oies sauvages ou des troupeaux d’éléphants. Mais, cette fois, c’est une nouvelle étape de l’évolution qui vient de s’enclencher, aux conséquences inattendues. Le règne animal devait enfin avoir une place sur Internet, une place autre
que celle dévolue aux vidéos d’animaux ou aux jeux en ligne comme Farmville sur Facebook. Les initiatives furent de plus en plus nombreuses, le plus souvent dupliquant les applications de l’Internet des objets.
Tous les moments de la vie de nos animaux domestiques ont ainsi donné lieu à des solutions numériques : retrouver sa tortue dans le jardin du voisin, dresser et contrôler son chien à distance, gérer les entrées et les sorties des animaux ou leur alimentation, etc. Cela fait également longtemps que les éleveurs implantent des capteurs sur les bêtes de leur cheptel pour mesurer plusieurs paramètres, modéliser les données grâce à des logiciels d’analyse prédictive et ainsi optimiser les étapes clés de l’élevage, comme ne pas manquer les moments propices pour l’insémination artificielle de sa vache laitière,
en prévenant l’éleveur par un simple SMS.
« Cette fois, c’est une nouvelle étape de l’évolution qui
vient de s’enclencher, aux conséquences inattendues. »