Les acteurs du numérique et de la data en Europe ne sont pas au bout de leur peine. Le marché est peut-être unique, mais la législation – en vigueur et à venir – est multiple. La mise en œuvre pratique des textes, souvent imbriqués, est complexe et peu intelligible. Petit aperçu de ce labyrinthe.
 Si l’Union européenne (UE) a déjà pris plusieurs mesures depuis 2014 afin de faciliter le développement d’une économie des données (1), elle entend, dans le cadre de sa stratégie pour les données et des objectifs fixés pour la « décennie numérique » (2), compléter les textes existants afin de créer de nouveaux droits et obligations destinés à favoriser l’accès et le partage des données, le développement des technologies et la souveraineté numérique. D’où le foisonnement de textes législatifs qui vont bouleverser considérablement l’écosystème de l’économie numérique et des données.
Si l’Union européenne (UE) a déjà pris plusieurs mesures depuis 2014 afin de faciliter le développement d’une économie des données (1), elle entend, dans le cadre de sa stratégie pour les données et des objectifs fixés pour la « décennie numérique » (2), compléter les textes existants afin de créer de nouveaux droits et obligations destinés à favoriser l’accès et le partage des données, le développement des technologies et la souveraineté numérique. D’où le foisonnement de textes législatifs qui vont bouleverser considérablement l’écosystème de l’économie numérique et des données.
Chantier de la « décennie numérique »
Les principaux acteurs concernés (notamment les fabricants d’objets connectés, les fournisseurs de services d’intermédiation de données et les prestataires de cloud) devront tenir compte de ces nouvelles obligations et anticiper leur entrée en application dans la conception de leurs solutions et de leurs produits, ainsi qu’au sein de leur documentation contractuelle. Pas si simple. Tour d’horizon de ces nouveaux textes :
• Data Governance Act (DGA). Ce règlement sur la gouvernance des données (3) a été adopté le 30 mai 2022 et entrera en application à partir du 24 septembre 2023, avec pour objectif de favoriser la disponibilité des données, de renforcer les mécanismes de partage et d’augmenter la confiance dans les intermédiaires de données. Ainsi, le DGA adresse trois grandes thématiques : conditions d’accès et de réutilisation des « données protégées » détenues par des organismes publics ; régulation des fournisseurs de services d’intermédiation de données ; régulation de l’utilisation altruiste des données. Sur le premier point, le DGA vient compléter la directive « Open Data » de 2019, mais ne crée pas d’obligation de mise à disposition pour les organismes publics (4). Il vient encadrer les réutilisations qui peuvent être faites de ces données protégées en veillant (5) à les préserver (6). Concernant les deux autres points, le DGA crée deux régimes spécifiques et dédiés pour les services d’intermédiation de données (7) et les organisations altruistes en matière de données (8). Les services d’intermédiation de données (data marketplaces ou data pool par exemple) seront soumis à une notification auprès d’une autorité compétente préalablement à tout début d’activité et auront notamment l’obligation de fournir les services selon des conditions équitables, transparentes et non-discriminatoires, de prendre des mesures pour assurer l’interopérabilité avec d’autres services d’intermédiation de données, de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour empêcher l’accès et le transfert illicite de données non-personnelles. Ils devront également notifier aux détenteurs de données en cas d’accès, de transfert ou d’utilisation non-autorisés aux données non-personnelles partagées. De leur côté, les organisations altruistes se verront notamment imposer la tenue d’un registre des utilisations des données, la publication d’un rapport annuel d’activité, des obligations de transparence vis-à-vis des personnes concernées ou des détenteurs de données (objectifs d’intérêt général, finalités des traitements) et de sécurisation des données non-personnelles.
Le DGA crée enfin un régime restrictif de transfert des données non-personnelles hors-UE similaire au régime prévu par le RGPD.
• Data Act (DA). Ce projet de règlement sur les données (9) a été soumis par la Commission européenne le 23 février 2022. Un objectif d’adoption ambitieux a été fixé à mi-2023, pour une entrée en application douze mois après son adoption. Il s’agit de faciliter l’accès aux données et leur utilisation, de favoriser leur portabilité, d’améliorer l’interopérabilité des solutions et infrastructures et enfin de favoriser la création de valeur autour de la donnée. Sont notamment impactés : les fabricants et distributeurs d’objets connectés et les fournisseurs de services connexes basés sur l’utilisation de données générées par ces objets, tout détenteur et destinataire de données, les prestataires et utilisateurs de services cloud (IaaS, PaaS, SaaS) ou encore les opérateurs de data spaces.
Portabilité des données et services de cloud Le DA prévoit notamment des obligations pour les fabricants ou distributeurs d’objets connectés qui viennent compléter les obligations d’information et de portabilité prévues par le RGPD, comme l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur les données générées par l’usage des objets et les conditions d’accès et de partage de telles données, ainsi qu’une obligation de mise à disposition gratuite et prompte (le cas échéant en temps réel et continu) des données générées par des objets connectés à leurs utilisateurs ou à un tiers à la demande de l’utilisateur, et ce dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes, non-discriminatoires et non-exclusives. Ces obligations sont complétées par des interdictions (par exemple des clauses restreignant les droits des utilisateurs d’objets ou des clauses abusives imposées aux petites et moyennes entreprises). Objets connectés, dossiers médicaux, … Le Data Act impose par ailleurs une série d’obligations aux prestataires de services cloud en matière de migration de données et d’interopérabilité (par exemple supprimer les obstacles commerciaux, techniques et contractuels empêchant le client de porter ses données, applications ou autres actifs numériques vers d‘autres prestataires ; assurer une période transitoire de migration de 30 jours avec assistance ; ou encore assurer la compatibilité de ses services avec les normes d’interopérabilité de la Commission européenne).
• European Health Data Space (EHDS). La proposition de règlement sur l’espace européen des données de santé (10) a été soumise par la Commission européenne le 3 mai 2022. L’UE entend adopter ce texte d’ici 2025, pour une entrée en application douze mois après sa publication. L’objectif est triple : établir les règles régissant l’espace européen des données de santé afin d’améliorer et garantir aux personnes physiques un accès sûr à leurs propres données de santé et un contrôle sur ces données dans le contexte des soins de santé (dite « utilisation primaire ») ; améliorer le fonctionnement du marché unique pour la mise au point et l’utilisation de produits et services de santé innovants fondés sur des données de santé, et veiller à ce que les chercheurs et les entreprises innovantes puissent tirer le meilleur parti des données de santé disponibles pour leurs travaux (dite « utilisation secondaire ») ; établir un cadre juridique uniforme pour le développement, la commercialisation et l’utilisation des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME). Dans le cadre de l’utilisation primaire des données, les citoyens de l’UE auront à leur disposition des droits et mécanismes supplémentaires complétant leurs droits existants au titre du RGPD sur leurs données de santé électroniques.
Concernant l’utilisation secondaire, le projet de règlement EHDS vient encadrer avec précision les pratiques des chercheurs et acteurs de l’industrie de santé (par exemple : limitation des catégories de données pouvant être utilisées, encadrement des finalités autorisées) et leur imposer des obligations (sécurité des solutions utilisées, transparence sur le calcul des redevances générées par l’utilisation secondaire).
• Artificial Intelligence Act (AIA). Cette proposition de règlement sur l’intelligence artificielle (11) a été soumise le 21 avril 2021 par la Commission européenne. L’adoption de ce texte est pressentie à horizon 2024, pour une entrée en application entre 18 et 24 mois après son adoption. Le texte vise à créer les conditions propices au développement et à l’utilisation d’une IA de pointe, éthique, sûre et digne de confiance dans l’UE. Pour se faire, l’approche est technologiquement neutre et le texte met en place des règles impératives, applicables de façon proportionnée en fonction des risques que présentent les systèmes d’IA concernés. Ainsi, les IA présentant un risque inacceptable pour les personnes sont interdites ; celles présentant un haut risque se voient imposer un certain nombre d’obligations; celles présentant un risque faible sont soumises à des obligations de transparence et d’information vis-à-vis des utilisateurs ; et enfin celles présentant un risque résiduel ne sont pas soumises au projet de règlement AIA, mais régulées par l’adoption volontaire de code de conduite et/ou de charte éthique (12).
• Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA). Un accord politique a été conclu sur le DMA (13) le 24 mars 2022 et sur le DSA (14) le 23 avril 2022, suivi d’un vote final au Parlement européen le 5 juillet dernier. Une fois adoptés respectivement en juillet et en septembre 2022, le DMA entrera en application six mois après l’entrée en vigueur, et le DSA quinze mois après l’entrée en vigueur ou à partir du 1er janvier 2024, la date la plus tardive étant retenue (15).
• Modifications de textes existants. Plusieurs autres textes sont également en cours de révision. La directive NIS (16) est modifiée par le projet de directive NIS2, dont le champ d’application a été considérablement élargi, puisqu’il vise désormais à réguler beaucoup plus d’organisations et entreprises et qu’il renforce les obligations à la charge des acteurs concernés en imposant notamment des obligations renforcées en termes de gestion des risques, de notification des incidents et de divulgation des vulnérabilités (17). La directive Machines (18) devient un projet de règlement Machines (19), visant principalement une numérisation de la documentation en la matière (instructions d’utilisation et déclaration) et la mise en place d’évaluations de conformité (pour certaines catégories de produits). De son côté, la directive ePrivacy (21), transformée en projet de règlement ePrivacy peine à voir le jour depuis la publication de sa première version en janvier 2017. De nombreux points restent encore et toujours en débat, notamment sur le régime applicable au dépôt de cookies et à la prospection commerciale.
Imbrication des textes parfois peu intelligible
Ces textes sont ambitieux et mêlent approche globale et sectorielle. Il en résulte une imbrication parfois peu intelligible des différents mécanismes et obligations pesant sur les acteurs qui multiplient souvent de nombreuses casquettes et entrent donc simultanément dans les champs d’application de plusieurs de ces textes. Bien qu’il soit louable de vouloir emboîter le pas au développement exponentiel de la valeur des données et du numérique, on peut s’interroger sur l’efficacité d’une telle multiplication de textes qui entraîne malheureusement la publication de textes peu aboutis, péniblement interopérables, voire difficilement transposables à la pratique des industries qu’ils visent. @

 « Si cette étude n’est pas liée à une procédure de contrôle ou de sanction, elle s’inscrit néanmoins dans l’une des thématiques prioritaires de contrôles puisqu’en 2022 la Cnil vérifiera la conformité au RGPD des professionnels du secteur [en l’occurrence de la prospection commercial, dont la publicité en ligne, ndlr], en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris, des nombreux intermédiaires de cet écosystème (aussi appelés data brokers) », précise le gendarme français des données et des fichiers informatiques.
« Si cette étude n’est pas liée à une procédure de contrôle ou de sanction, elle s’inscrit néanmoins dans l’une des thématiques prioritaires de contrôles puisqu’en 2022 la Cnil vérifiera la conformité au RGPD des professionnels du secteur [en l’occurrence de la prospection commercial, dont la publicité en ligne, ndlr], en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris, des nombreux intermédiaires de cet écosystème (aussi appelés data brokers) », précise le gendarme français des données et des fichiers informatiques.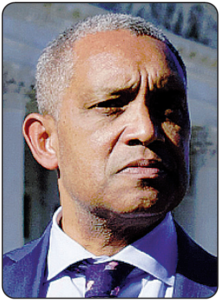 Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (
Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin ( D’après l’Union internationale des télécommunications (UIT), le câble sous-marin de communication est « un câble posé dans le fond marin, ou ensouillé à faible profondeur, destiné à acheminer des communications » (
D’après l’Union internationale des télécommunications (UIT), le câble sous-marin de communication est « un câble posé dans le fond marin, ou ensouillé à faible profondeur, destiné à acheminer des communications » (