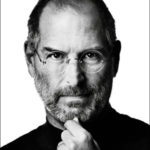Cela fait une décennie que la loi Hadopi du 12 juin 2009 a été promulguée – mais sans son volet pénal, censuré par le Conseil constitutionnel, qui sera rectifié et promulgué quatre mois plus tard. Franck Riester en fut le rapporteur à l’Assemblée nationale. Jamais une loi et une autorité n’auront été autant encensées que maudites.
 Alors que le conseiller d’Etat Jean-Yves Ollier doit rendre au ministre de la Culture Franck Riester (photo), qui l’a missionné, son rapport de réflexion sur « l’organisation de la régulation » – fusion Hadopi-CSA ? – dans la perspective de la future loi sur l’audiovisuel, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) fête ses dix ans. Car il y a en effet une décennie que la loi du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet » a porté cette autorité publique sur les fonts baptismaux. Cette loi, dite « Création et Internet » – ou loi « Hadopi » – a donc modifié le code de la propriété intellectuelle (CPI) pour remplacer l’ARMT (1) par l’actuelle Hadopi. Car, face à la montée du piratage sur Internet boosté par les réseaux de partage décentralisés peer-to-peer, le président de la République de l’époque – Nicolas Sarkozy – rêvait d’instaurer des radars automatiques sur Internet en s’inspirant des radars routiers qu’il avait lui-même décidé lorsqu’il était ministre l’Intérieur. Autant ces derniers, installés au nom de la sécurité routière, n’ont jamais fait l’objet d’aucun débat parlementaire (2), autant le dispositif d’infraction dans la lutte contre le piratage sur Internet a âprement été discuté au Parlement.
Alors que le conseiller d’Etat Jean-Yves Ollier doit rendre au ministre de la Culture Franck Riester (photo), qui l’a missionné, son rapport de réflexion sur « l’organisation de la régulation » – fusion Hadopi-CSA ? – dans la perspective de la future loi sur l’audiovisuel, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) fête ses dix ans. Car il y a en effet une décennie que la loi du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet » a porté cette autorité publique sur les fonts baptismaux. Cette loi, dite « Création et Internet » – ou loi « Hadopi » – a donc modifié le code de la propriété intellectuelle (CPI) pour remplacer l’ARMT (1) par l’actuelle Hadopi. Car, face à la montée du piratage sur Internet boosté par les réseaux de partage décentralisés peer-to-peer, le président de la République de l’époque – Nicolas Sarkozy – rêvait d’instaurer des radars automatiques sur Internet en s’inspirant des radars routiers qu’il avait lui-même décidé lorsqu’il était ministre l’Intérieur. Autant ces derniers, installés au nom de la sécurité routière, n’ont jamais fait l’objet d’aucun débat parlementaire (2), autant le dispositif d’infraction dans la lutte contre le piratage sur Internet a âprement été discuté au Parlement.