La France préside le Conseil de l’Union européenne (UE) durant ce premier semestre 2022, alors que les négociations sur le Digital Markets Act (DMA) débutent. C’est l’occasion pour Orange, Deutsche Telekom, Telefónica ou encore Telenor de tenter d’imposer aux géants du Net le « peering payant ».
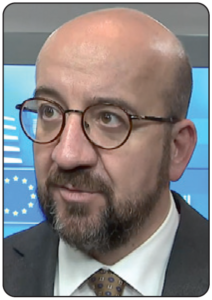 Un mois après avoir été approuvée par le Parlement européen, lors du vote en séance plénière du 15 décembre dernier à Strasbourg (1), la proposition de législation sur les marchés numériques – appelée Digital Markets Act (DMA) – va maintenant faire l’objet de négociations entre les eurodéputés et les vingt-sept gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil de l’Union européenne (UE), lequel est présidé non pas par Emmanuel Macron mais par Charles Michel (photo). Cette approbation du projet de DMA vaut en effet mandat pour la négociation qui s’engage.
Un mois après avoir été approuvée par le Parlement européen, lors du vote en séance plénière du 15 décembre dernier à Strasbourg (1), la proposition de législation sur les marchés numériques – appelée Digital Markets Act (DMA) – va maintenant faire l’objet de négociations entre les eurodéputés et les vingt-sept gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil de l’Union européenne (UE), lequel est présidé non pas par Emmanuel Macron mais par Charles Michel (photo). Cette approbation du projet de DMA vaut en effet mandat pour la négociation qui s’engage.
Les « telcos » se sentent exclus du DMA
« Les mesures horizontales comme le Digital Markets Act jouent un rôle crucial et, pour cette raison, nous les appuyons fermement. En outre, nous devons également tenir compte [du fait qu’]une partie importante et croissante du trafic du réseau est générée et monétisée par les plateformes des Big Tech, mais cela nécessite des investissements et une planification de réseau continus et intensifs de la part du secteur des télécommunications », ont fait valoir les principaux opérateurs télécoms historiques d’Europe réunis au sein de leur organisation de lobbying Etno (2).
Et la douzaine de signataires – Telekom Austria Vivacom (ex- Bulgarian Telecom), Proximus (ex-Belgacom), Telenor, KPN, Altice Portugal, Deutsche Telekom, BT Group, Telia Company, Telefónica, Vodafone, Orange et Swisscom – de suggérer de rééquilibrer les forces en présence en faisant mieux payer les GAFAM via le « peering payant » (même si cette facturation des interconnexions réseau n’est pas explicitement mentionnée) : « Ce modèle – qui permet aux citoyens de l’UE de profiter des fruits de la transformation numérique – ne peut être durable que si ces grandes plateformes technologiques contribuent également équitablement aux coûts du réseau ». Les opérateurs télécoms semblent avoir le sentiment d’être exclus du DMA et des négociations qui s’annoncent. « Les nouvelles stratégies industrielles [doivent] permett[re] aux acteurs européens – y compris les opérateurs télécoms – de rivaliser avec succès dans les espaces de données mondiaux, afin de développer une économie de données européenne fondée sur de véritables valeurs européennes », préviennent ils. Ce futur règlement européen DMA ne s’intéresse en effet qu’aux grandes plateformes de services en ligne dits « essentiels » et dont il dresse « une liste noire » – dixit le communiqué du Parlement européen (3) – de leurs pratiques : lorsqu’elles agissent comme des « contrôleurs d’accès » – ou gatekeepers : cela va des « économies d’échelle extrêmes », des « effets de réseau très importants », des « effets de verrouillage », à l’« intégration verticale » ou encore aux « avantages liés aux données », le tout combiné à des « pratiques déloyales ». Les GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et bien d’autres géants de l’Internet – sont concernés au premier chef car ils peuvent abuser de leur position dominante « au détriment des prix, de la qualité, des normes en matière de vie privée et de sécurité, d’une concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans ce domaine ». Griefs potentiels auxquels peuvent s’ajouter des « conséquences sociétales et économiques négatives ».
Aux yeux du Parlement européen, sont considérés comme des « services de plateforme essentiels » une flopée d’acteurs du numérique tels que, pêle-mêle : « les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation tels que les dispositifs intelligents, l’Internet des objets ou les services numériques embarqués dans les véhicules, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation [les messageries instantanées ou les messageries d’e-mails, ndlr], les services d’informatique en nuage, les services d’assistant virtuel, les navigateurs web, la télévision connectée et les services de publicité en ligne » (4). Il n’en reste pas moins que les GAFAM sont les premiers visés puisque pour tomber sous le coup du règlement DMA et être qualifié de « contrôleurs d’accès », il faut réaliser 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans l’espace économique européen (5) et avoir une capitalisation boursière d’au moins 80 milliards d’euros (6), ainsi que totaliser au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois ainsi que de plus de 10 000 entreprises utilisatrices.
Des garde-fous et des amendes salées
Outre le fait d’être un garde-fou des gatekeepers, le futur DMA – consacré aux «marchés contestables et équitables dans le secteur numérique » (7) – donne pouvoir à la Commission européenne pour mener des enquêtes de marché et appliquer des sanctions, lesquelles représentent « au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent ». @
Charles de Laubier

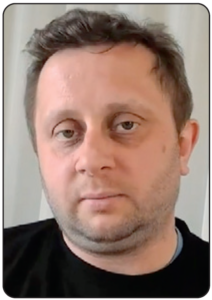 « Souveraineté des données » (50 fois), « cloud souverain » (2 fois), mais aussi « cloud souverain européen », « souveraineté des données en Europe », « souveraineté numérique de l’Europe », « cloud de données sécurisées et souveraines », « souveraineté et de sécurité des données », « bases de données souveraines » : le document d’enregistrement boursier du groupe OVH (alias OVHcloud), approuvé le 17 septembre 2021 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), montre que la « souveraineté » est devenue le leitmotiv dans le nuage.
« Souveraineté des données » (50 fois), « cloud souverain » (2 fois), mais aussi « cloud souverain européen », « souveraineté des données en Europe », « souveraineté numérique de l’Europe », « cloud de données sécurisées et souveraines », « souveraineté et de sécurité des données », « bases de données souveraines » : le document d’enregistrement boursier du groupe OVH (alias OVHcloud), approuvé le 17 septembre 2021 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), montre que la « souveraineté » est devenue le leitmotiv dans le nuage.