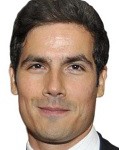En fait. Le 29 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que la France allait consacrer à l’intelligence artificielle (IA) 1,5 milliard d’euros d’ici à 2022 (la fin de son quinquennat). Le 28 mars, le rapport du député (LREM) Cédric Villani sur l’IA a été publié. Il souligne le retard de l’Europe.
En clair. L’Etat français devient un peu plus « technocratique ». C’est tout juste s’il ne ferait pas de l’intelligence artificielle (IA) une cause nationale. Dans son discours au Collège de France (1), le 29 mars, le chef de l’Etat a fait part de sa décision de constituer « un hub de recherche au meilleur niveau mondial en IA, grâce à la mise
en place d’un programme national », afin de faire de la France « l’un des leaders » dans ce domaine assez conceptuel et complexe. Pour financer cette ambition, Emmanuel Macron débloque des « crédits publics » à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur cinq ans (2018-2022). Une bonne partie proviendra du Fonds pour l’innovation de rupture, constitué en janvier dernier au sein de l’établissement public Bpifrance et doté, lui, de 10 milliards d’euros issus de ventes d’actifs Engie et Renault effectuées au second semestre 2017 (pour 1,6 milliard d’euros) et de titres EDF et Thales (8,4 milliards d’euros). Ce fonds a déjà prévu d’allouer 70 millions d’euros par an à des
start-up de la « deep tech » : deep learning, deep mining, et bien sûr le deep AI. A
ne pas confondre avec le « Deep Web » ou le « Dark Net », qui constituent la face cachée du réseau où se mêlent bonnes intentions et malversations (2). Pour le financement de start-up spécialisées dans l’IA, 100 millions d’euros leur seront consacrés dans les prochains mois. A part le fonds de Bpifrance, d’autres sources publiques seront mis à contribution telles que le Plan d’investissement dans les compétences, et le Fonds pour la transformation de l’action publique. Il s’agit aussi d’endiguer la fuite des cerveaux, la France étant reconnues pour ses mathématiciens
et ses informaticiens.
Mais ces 1,5 milliard d’euros de « crédits publics » restent somme toute très modestes par rapport, par exemple, aux 22 milliards de dollars que la Chine a prévu d’investir d’ici 2020 dans l’IA. Les Etats-Unis, eux, sont à la pointe avec les GAFAM qui ont fait de l’IA leur fonds de commerce. Mais Emmanuel Macron table sur l’engouement qu’il espèce susciter en France, malgré le retard de l’Hexagone et celui de l’Europe (3), en attirant les investissements d’entreprises privées pour développer ce qu’il appelle
« l’écosystème IA » : ont déjà répondu à l’appel Samsung (centre de recherche IA), Fujitsu (idem), Microsoft (formation), Google (chaire), IBM (recrutements), et DeepMind, filiale d’Alphabet (laboratoire). @