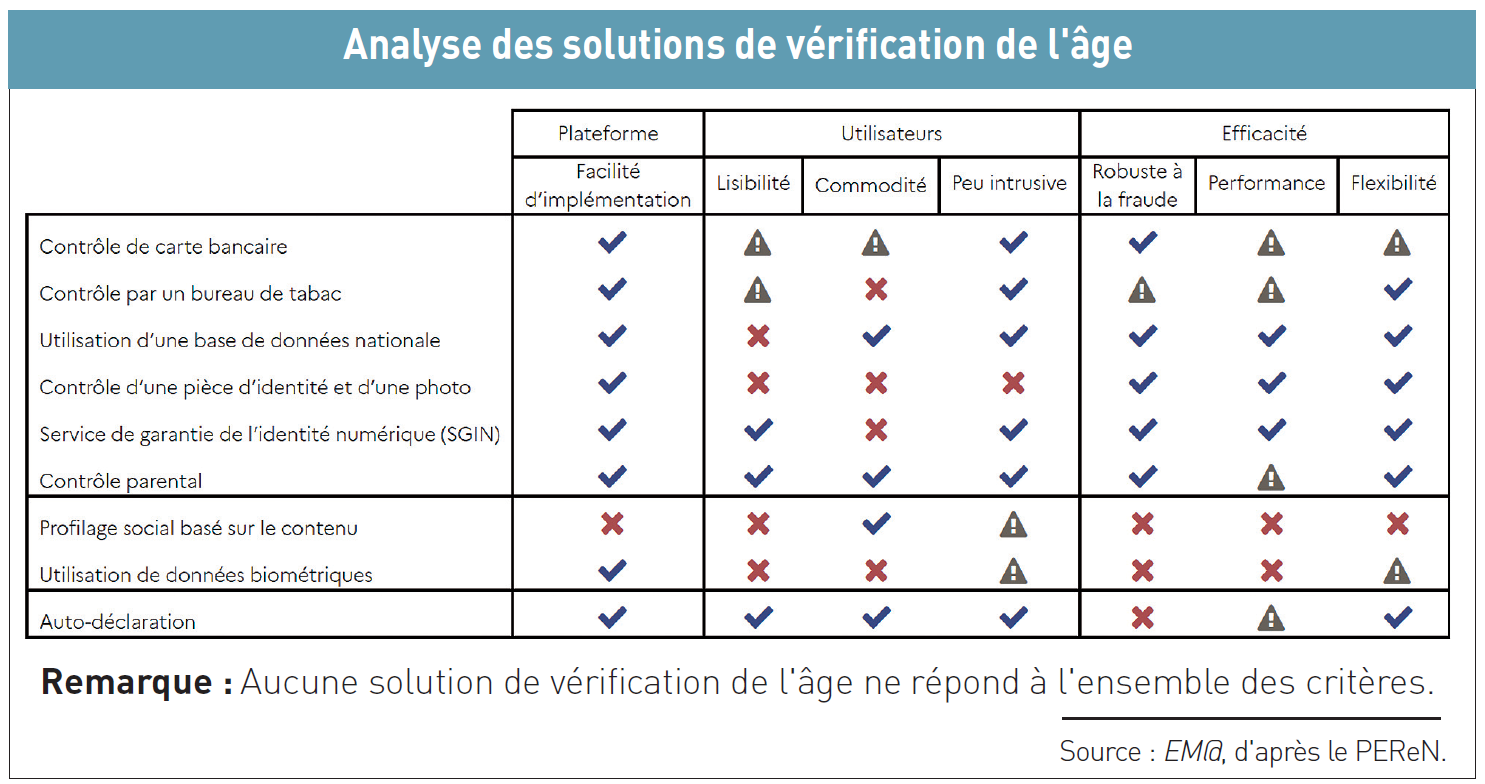Prise le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, la décision de blocage des adresses Internet de Z-Library – vaste bibliothèque en ligne – est applaudie par les maisons d’édition en France. Mais le piratage d’ebooks, avec ses sites miroirs désormais listés par l’Arcom, est sans frontières.
 Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free sont obligés rendre inaccessible sur l’Hexagone la bibliothèque en ligne Z-Library, condamnée pour contrefaçon de livres numériques. Edition Multimédi@ a constaté que le blocage sur les « box » de ces fournisseurs d’accès à Internet (FAI) était effectif : « Désolé, impossible d’accéder à cette page », nous a confirmé le navigateur en voulant par exemple aller sur « fr.z-lib.org » ou sur « http://z-lib.org ». Le jugement du 25 août 2022, que nous nous sommes procurés (1), liste 209 noms de domaine de Z-Library à rendre inaccessibles « pendant une durée de 18 mois ». Sont ainsi neutralisés autant de sites dits « miroirs » permettant jusqu’alors d’entrer dans cette bibliothèque parallèle géante, qui est une des multiples déclinaisons de Library Genesis d’origine russe.
Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free sont obligés rendre inaccessible sur l’Hexagone la bibliothèque en ligne Z-Library, condamnée pour contrefaçon de livres numériques. Edition Multimédi@ a constaté que le blocage sur les « box » de ces fournisseurs d’accès à Internet (FAI) était effectif : « Désolé, impossible d’accéder à cette page », nous a confirmé le navigateur en voulant par exemple aller sur « fr.z-lib.org » ou sur « http://z-lib.org ». Le jugement du 25 août 2022, que nous nous sommes procurés (1), liste 209 noms de domaine de Z-Library à rendre inaccessibles « pendant une durée de 18 mois ». Sont ainsi neutralisés autant de sites dits « miroirs » permettant jusqu’alors d’entrer dans cette bibliothèque parallèle géante, qui est une des multiples déclinaisons de Library Genesis d’origine russe.
Listes noires des sites et des miroirs
Le Syndicat national de l’édition (SNE) et une douzaine de maisons d’édition (Actes Sud, Albin Michel, Cairn, Editis, Hachette Livre, Humensis, Lefebvre-Sarrut, LexisNexis, Madrigall, Maison des Langues, Odile Jacob, et les Presses de Science Po) avaient attaqué le 29 juin 2022 le site web Zlibrary devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Vingt-cinq jours après le rendu de la décision de blocage (le temps que la signification du jugement aux FAI soit faite aux interressés), le SNE s’est notamment félicité des « nouvelles prérogatives confiées à l’Arcom en matière d’extension du blocage à tout lien redirigeant vers une réplique de site bloqué ».
Et pour cause, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (née de la fusion entre le CSA et l’Hadopi) se retrouve aux avant-postes de la lutte contre le piratage en ligne. Et ce, depuis la promulgation il y a presqu’un an de la loi du 25 octobre 2021 « relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » (2). C’est cette loi « Anti-piratage » qui a porté sur les fonts baptismaux législatifs l’Arcom – présidée par Roch-Olivier Maistre (photo) jusqu’en janvier 2025 – en lui attribuant de nouveaux pouvoirs de régulation, notamment en la chargeant de constituer « une liste » – surnommée, hors texte de loi, « liste noire » – des « services porta[n]t atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, l’Arcom a le pouvoir supplémentaire de « lutte contre les sites miroirs ». Ainsi, la loi « anti-piratage » a rajouté une disposition « sites miroirs » dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) qui permet à « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » – par exemple l’un des douze maisons d’édition dans l’affaire « ZLibrary » – de saisir l’Arcom pour lui demander de mettre à jour la décision de blocage avec les nouvelles adresses Internet des sites miroirs. En l’occurrence, le blocage à effectuer par les FAI devra suivre l’évolution de la liste noire qui dépassera sûrement les 209 noms de domaine initialement identifiées. Pour l’heure, dans l’affaire « Z-Library », la décision de justice a été rendue le 25 août 2022 : il ne reste plus qu’à un ayant droit concerné de saisir l’Arcom en s’appuyant sur l’article L. 331-27 du CPI. Que dit-il ? « Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2 [du CPI, nous y reviendrons, ndlr], l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique [Arcom], saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision (…) d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision ». Bref, toute nouvelle apparition d’un site miroir lié de près ou de loin à la plateforme pirate condamnée devra faire aussi l’objet d’un blocage de la part non seulement des quatre principaux opérateurs télécoms français mais aussi des moteurs de recherche ou des annuaires de référencement (si le juge le décide).
Pour ce faire, c’est l’Arcom qui communiquera « précisément » à tous ces acteurs « les données d’identification du service en cause » à bloquer et à déréférencer. La loi « anti-piratage » prévoit même que l’Arcom passe des accords avec« les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne » pour déterminer notamment les conditions d’« information réciproque » sur l’existence de tout site miroir.
Saisines « L. 336-2 » et « L. 331-27 »
L’Arcom peut en outre – « en cas de difficulté » – demander aux services de communication au public en ligne de se justifier. En lisant la fin de l’article L. 331-27 du CPI, l’on comprend implicitement que l’Arcom peut saisir, « en référé ou sur requête », l’autorité judiciaire pour « ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services ». Cette saisine-là peut se faire « sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. ». Il y a donc deux types de saisine des tribunaux pour faire bloquer et déréférencer des sites web pirates d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur : la saisine « L. 336-2 » par des titulaires de droits, leurs ayants droit, des organismes de gestion collective, des organismes de défense professionnelle, ou même par le CNC – le Centre national du cinéma et de l’image animée (3) ; la saisine « L. 331-27 » par l’Arcom (bien que cela ne soit pas clairement spécifié dans le texte de loi) lorsqu’elle-même est saisie par un titulaire de droits concerné par la décision judiciaire rendue à l’issue de la première saisine. Cette justice à deux détentes (liste noire initiale des sites web à neutraliser, liste noire mise à jour avec les sites miroirs) tend vers le black-out – total ? – de la plateforme incriminée. Prochains : Pirate Library Mirror, Bookys, … « Ce succès collectif vient conclure l’expérimentation inédite de cette procédure pour le livre, et ouvre la voie à de nouvelles actions – des éditeurs et du SNE – de blocage et de déréférencement, rapides et systématiques, contre des sites web proposant des contenus illicites violant le droit d’auteur », a prévenu le syndicat présidé par Vincent Montagne (PDG du groupe franco-belge Média-Participations).
Autant lors de la précédente affaire « Team Alexandriz », dont les responsables ont été condamnés au pénal en mai 2021 au bout de dix ans de procédure judiciaire (4), les sites miroirs passaient sous les radars, autant depuis la loi « Anti-piratage » d’octobre 2021 permet aux ayants droit et à l’Arcom d’agir devant la justice contre la résurgence de sites miroir dans une même affaire de type « Z-Library ». « Se présentant “comme une bibliothèque gratuite depuis 2009”, mais proposant un modèle payant d’accès aux œuvres contrefaites, le site Z-Library accessible via de multiples adresses, proposait un accès à plus de 8 millions de livres – tous secteurs éditoriaux confondus – et 80 millions d’articles piratés », précise le SNE qui compte 700 éditeurs français adhérents. Le site Z-Library (ex-BookFinder ou BookFi, alias B.ok.cc), affichait, lui, avant d’être blacklisté, un catalogue de 11,1 millions de livres et plus de 84,8 millions d’articles. Quelques jours avant d’être bloqué par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, cette « plus grandes bibliothèques en ligne dans le monde » lançait une « campagne de collecte » jusqu’au 1er octobre 2022 en guise d’« appel de fonds à tous ceux qui veulent contribuer encore plus au soutien et au développement de notre projet » (5). Certains internautes avisés peuvent contourner le blocage-filtrage par nom de domaine mis en place par les FAI (les DNS étant retirés de leurs répertoires d’adresses IP) et les principaux moteurs de recherche (déréférencement).
La précédente affaire « Team Alexandriz » avait été enclenchée il y a dix ans, avec là aussi la plainte du SNE, déposée en novembre 2012 avec six grands éditeurs français – Hachette, Editis, Gallimard, Albin Michel, La Martinière et Actes Sud. Le site qui se revendiquait comme le « n°1 sur les ebooks FR » avait cessé de fonctionner dès fin août 2013 mais la procédure judiciaire a continué pour s’éterniser près de dix ans (6), jusqu’à la condamnation pour contrefaçon de neuf des douze prévenus avec « circonstance aggravante de bande organisée ». Entre mai 2010 et juin 2013, était-il précisé, ce fut plus de 23.942 livres qui avaient été piratés, qu’il s’agisse de livres numériques sur lesquels les mesures de protection avaient été retirées ou de livres imprimés illégalement numérisés et corrigés (7). Certains responsables de Team Alexandriz ont écopé de peines d’emprisonnement avec sursis et le tribunal a condamné les neuf à « 10.000 euros de dommages et intérêts pour chaque éditeur et pour le SNE, en réparation du préjudice subi ». C’est relativement peu au regard de la peine maximale qu’ils encouraient : trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, selon l’article L335-4 du CPI (8).
Avec la loi « Anti-piratage » et le renfort de l’Arcom dans les actions judiciaires en « procédure accélérée », le SNE et les maisons d’éditions disposent désormais d’un double-levier procédural à leur disposition. A qui le tour : à Pirate Library Mirror ? Ce site web déclare : « Nous violons délibérément la loi sur le droit d’auteur dans la plupart des pays. (…) Miroir – Nous sommes strictement un miroir des bibliothèques existantes. (…) La première bibliothèque que nous avons reflétée est Z-Library. C’est une bibliothèque populaire (et illégale). Ils ont pris la collection Library Genesis et l’ont rendue facilement consultable » (9). Ou bien à Bookys ? Ce site web le reconnaît : « En rendant le téléchargement gratuit, Bookys enfreint les règles de protection des droits d’auteurs » (10).
Reste que la portée de ces condamnations au pénal pour contrefaçon a ses limites puisque celles-ci ne s’appliquent qu’en France. Alors que les sites et de leurs sites miroirs présumés pirates sont sans frontières. Le règlement européen sur les services numériques – le DSA (Digital Services Act) – est sur le point d’entrer en vigueur. Il prévoit lui aussi le blocage mais sur décision d’un juge. Ce ne seront ni les FAI, ni les plateformes numériques, ni les régulateurs qui peuvent bloquer d’eux-mêmes les contenus piratés.
Frontières : vers un blocage européen
L’affaire « Z-Library » apparaît comme un marqueur dans l’histoire de la lutte contre le piratage de contenus protégés. Du moins en France, en attendant des actions au niveau européen lorsque le DSA sera pleinement applicable. Si les livres numériques sont concernés par cette décision de blocage du 25 août 2022, à laquelle l’Arcom contribue devant la justice avec la mise à jour de sa liste des sites miroirs et d’éventuels nouveaux recours, le nouvel arsenal judicaire est à la disposition de toutes les industries culturelles : livre mais aussi musique, cinéma, retransmissions sportifs, ou encore jeux vidéo. @
Charles de Laubier
 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué l’an dernier dans une vidéo qu’il avait capitulé face aux russes et qu’il appelait les soldats de son pays à déposer les armes (1). L’acteur américain Morgan Freeman s’est exprimé en 2021 sur la chaîne YouTube néerlandaise Diep Nep pour dire : « Je ne suis pas Morgan Freeman. Ce que vous voyez n’est pas réel » (2). Car ces vidéos et de nombreuses autres postées sur les réseaux sociaux – lorsque ce ne sont pas des textes, des images ou des podcasts – sont des « deepfake », des contenus entièrement manipulés et détournés à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine (AM).
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué l’an dernier dans une vidéo qu’il avait capitulé face aux russes et qu’il appelait les soldats de son pays à déposer les armes (1). L’acteur américain Morgan Freeman s’est exprimé en 2021 sur la chaîne YouTube néerlandaise Diep Nep pour dire : « Je ne suis pas Morgan Freeman. Ce que vous voyez n’est pas réel » (2). Car ces vidéos et de nombreuses autres postées sur les réseaux sociaux – lorsque ce ne sont pas des textes, des images ou des podcasts – sont des « deepfake », des contenus entièrement manipulés et détournés à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine (AM).
 Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free sont obligés rendre inaccessible sur l’Hexagone la bibliothèque en ligne Z-Library, condamnée pour contrefaçon de livres numériques. Edition Multimédi@ a constaté que le blocage sur les « box » de ces fournisseurs d’accès à Internet (FAI) était effectif : « Désolé, impossible d’accéder à cette page », nous a confirmé le navigateur en voulant par exemple aller sur «
Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free sont obligés rendre inaccessible sur l’Hexagone la bibliothèque en ligne Z-Library, condamnée pour contrefaçon de livres numériques. Edition Multimédi@ a constaté que le blocage sur les « box » de ces fournisseurs d’accès à Internet (FAI) était effectif : « Désolé, impossible d’accéder à cette page », nous a confirmé le navigateur en voulant par exemple aller sur «  Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages (
Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages ( Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (
Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (