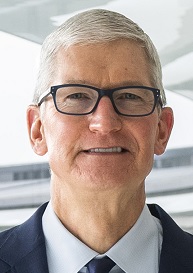« Nous sommes les réseaux sociaux » est un essai de Serge Abiteboul, un des sept membres du collège de l’Arcep, et de Jean Cattan, secrétaire général du Conseil national du numérique (CNNum). Ils prônent « une véritable régulation-supervision » des réseaux sociaux « opérée par la société ».

Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages (
1), ils lancent un appel : « Une véritable régulation supervision opérée par la société nous paraît souhaitable. Une telle initiative permettrait d’animer un débat citoyen pour choisir la modération que nous souhaitons ».
Les risques d’un Etat « modérateur »
« Oui à une régulation fondée sur un débat citoyen, une régulation par la société », prônent Serge Abiteboul et Jean Cattan, respectivement membre du collège de l’Arcep et secrétaire général du Conseil national du numérique (CNNum). Cette régulation-supervision par la société gagnerait ainsi «sa légitimité à imposer aux réseaux sociaux une modération raisonnable qui donnerait à tous les moyens de s’exprimer dans le respect de chacun ». Et de prendre en exemple Wikipedia : l’encyclopédie en ligne montre qu’« il est possible d’exercer collectivement une forme d’intelligence de modération qui fonctionne », en tirant parti des « dynamiques collectives vertueuses ». Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia (
2), a d’ailleurs lancé en 2019 un réseau social qu’il décrit comme « non-toxique » : WT.Social (
3). L’intelligence collective des internautes en guise de régulation des réseaux sociaux serait elle la solution ? L’autorégulation par les plateformes elles-mêmes montre ses limites ; la censure stricte des contenus porte atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’informer ; la modération rigoriste freine l’émergence de nouvelles idées. Par conséquent, une régulation-supervision par la société semble la bonne voie : « Nous sommes les réseaux sociaux », titrent justement les auteurs de cet essai.
Mais cette régulation-supervision doit-elle se faire par l’intelligence collective de la société civile elle-même et, donc, sans l’intervention d’une autorité de régulation relevant d’un Etat, ou bien faudrait-il que cette régulation-supervision soit encadrée par les pouvoirs publics (gouvernement, régulateur, législateur, justice, …) ? Serge Abiteboul et Jean Cattan rejettent d’emblée – et c’est heureux – la voie d’une régulation tout-étatique : « Une régulation-supervision qui consacrerait un tête-à-tête entre l’Etat et le réseau social ne serait pas (…) à l’abris d’un rejet de la société ». Ils prônent donc « une véritable contribution (…) de la société à la modération [qui] serait non seulement gage d’une plus grande acceptabilité mais surtout d’une plus grande qualité ». Pour autant, les deux auteurs écartent implicitement la voie – pourtant possible – d’une régulation-supervision par la seule société civile, à la manière de Wikipedia dont ils parlent – et où ce sont les 103,9 millions d’individus contributeurs et les 3.762 administrateurs, au 20 septembre 2022 (
4), qui ont voix au chapitre et non les régulateurs ni les gouvernements.
Au lieu de cela, le membre de l’Arcep et le secrétaire général du CNNum retiennent plutôt une approche à la manière de la « Mission Facebook ». A savoir : « Que les réseaux sociaux entrent dans un dialogue politique informé avec toutes les parties prenantes [gouvernement, législateur, justice, entreprises, société civile, …], collectivement ». Cette idée d’une « corégulation entre les plateformes et les autorités publiques » avait été évoquée par Mark Zuckerberg, PDG cofondateur de Facebook, et Emmanuel Macron, le président de la France, lors de leur rencontre en 2018 (
5). Le rapport de la « Mission Facebook », remis par Macron à Zuckerberg le 17 mai 2019 à l’Elysée (
6), a inspiré l’Europe sur certains points du DSA (Digital Services Act) : comme la « supervision » des moyens mis en œuvre par les plus grandes plateformes numériques – celles présentant un « risque systémique » – pour modérer les contenus nocifs. Mais le DSA, lui, n’associe pas directement la société civile et les internautes.
Europe : l’acte manqué du DSA
La « régulation-supervision » reste entre les mains de la Commission européenne (sur les très grandes plateformes), le nouveau Comité européen des services numériques (sur les services intermédiaires) et les régulateurs nationaux (en fonction du pays d’origine). La société civile, elle, reste absente de cette régulation-supervision des réseaux sociaux. « Un tel cadre [associant la société civile] pourrait enrichir le DSA [et] s’appliquer aussi au DMA [Digital Markets Act, ndlr], permettant ainsi à toute la société de participer à l’élaboration des objectifs de régulations », concluent les auteurs. En France, le Conseil d’Etat vient de recommander d’« armer la puissance publique dans son rôle de régulateur » (
7) des réseaux sociaux…
@
Charles de Laubier
 « La dernière fois qu’une entreprise qui n’était pas Samsung s’est retrouvée au sommet du marché mondial des smartphones, c’était en 2010 [avec Nokia en tête à l’époque, ndlr]. Et pour 2023, il y a maintenant Apple », a indiqué le cabinet d’études international IDC le 15 janvier dernier. « Le succès et la résilience continus d’Apple sont en grande partie imputables à la tendance croissante des smartphones haut de gamme, qui représentent maintenant plus de 20 % du marché mondial, alimentée par des offres de remplacement agressives et des plans de financement sans intérêts d’emprunt », souligne Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.
« La dernière fois qu’une entreprise qui n’était pas Samsung s’est retrouvée au sommet du marché mondial des smartphones, c’était en 2010 [avec Nokia en tête à l’époque, ndlr]. Et pour 2023, il y a maintenant Apple », a indiqué le cabinet d’études international IDC le 15 janvier dernier. « Le succès et la résilience continus d’Apple sont en grande partie imputables à la tendance croissante des smartphones haut de gamme, qui représentent maintenant plus de 20 % du marché mondial, alimentée par des offres de remplacement agressives et des plans de financement sans intérêts d’emprunt », souligne Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.
 Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.
Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord. Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages (
Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages (