Relancé sans succès il y a dix ans sous forme de magazine en ligne, FranceSoir – successeur du célèbre quotidien France Soir liquidé en 2012 – est depuis 2014 dirigé par un entrepreneur, Xavier Azalbert. Il se bat aujourd’hui pour garder son statut de « service de presse en ligne » que la CPPAP voudrait lui retirer.

Qu’il est loin le temps où France Soir – fleuron de la presse française durant les Trente-Glorieuses – tirait chaque à plus de 1 million d’exemplaires imprimés (
1). La chute du premier quotidien national de l’époque – créé par Pierre Lazareff après avoir repris le journal clandestin et résistant Défense de la France pour le rebaptiser en 1944 France Soir – n’est plus que de l’histoire ancienne.
La crise de la presse sur fond de tsunami numérique est passée par là (
2). C’est le 13 décembre 2011 que France Soir imprime sa dernière édition papier, pour basculer ensuite entièrement sur le Web et les mobiles. Ainsi en avait décidé son propriétaire d’alors, le Russe Alexandre Pougatchev. Le quotidien était passé sous la barre des 70.000 exemplaires (
3). La liquidation judiciaire de France Soir sera prononcée le 23 juillet 2012 et ses actifs seront revendus à une société de e-paiement, Cards Off, qui lancera l’année suivante le site FranceSoir.fr mais sans succès. C’est en 2014 que Xavier Azalbert (photo), ancien conseiller de McKinsey devenu entrepreneur financier, entre en scène en tant que président de Mutualize Corporation (ex- Cards Off), et, à partir de 2016, président et directeur de la publication FranceSoir. Le nombre de ses journalistes est réduit et le site web gratuit publie des dépêches AFP pour assurer tant bien que mal une information en continu.
Un site de presse en ligne controversé
Lorsqu’une grève est déclenchée par la rédaction de FranceSoir à partir de fin août 2019, il ne reste plus que quatre journalistes titulaires. Dénonçant la dégradation de leurs conditions de travail, ils seront tous licenciés par Xavier Azalbert « pour motif économique » au mois d’octobre suivant (
4). Durant la crise sanitaire due au coronavirus, le « journal sans journalistes » prend fait et cause pour l’hydroxychloroquine du professeur Didier Raoult, donne la parole au professeur spécialiste des épidémies Christian Perronne et fustige les décisions sanitaires du gouvernement.
FranceSoir.fr fait en outre la part belle au documentaire controversé « Hold-Up » qui, diffusé sur les réseaux sociaux, développe sur près de trois heures une théorie conspirationniste sur la pandémie de Covid- 19 («manipulation » des gouvernants) et remet en cause la gravité de la pandémie. FranceSoir est alors accusé de verser dans le complotisme et les fake news. En janvier 2021, les anciens journalistes de la rédaction ont lancé une pétition en ligne – avec le soutien du Syndicat national des journalistes (SNJ) – pour alerter la ministre de la Culture, alors Roselyne Bachelot, et interpeller le propriétaire du journal, Xavier Azalbert, « sur les dérives déontologiques récurrentes de ce média » (
5). Cette pétition compte à ce jour près de 2.300 signataires (
6).
 L’affaire « FranceSoir » devient politique
L’affaire « FranceSoir » devient politique
La locataire de la rue de Valois s’empare alors de l’affaire : « J’ai demandé que soit réexaminé le certificat d’IPG (information politique et générale) délivré au service de presse en ligne #FranceSoir, dont le terme est en principe septembre 2022, afin de vérifier dès maintenant que ses conditions d’octroi sont bien toujours respectées », tweete Roselyne Bachelot le 29 janvier 2021 (
7). Un audit anticipé de l’agrément de FranceSoir.fr est donc effectué le mois suivant (en février), pour aboutir finalement au maintien de l’agrément par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). « La preuve a été apportée de la présence de deux journalistes permanents et quatre pigistes », justifiera la rue de Valois auprès de l’AFP le 9 avril 2021. Le SNJ dénonce aussitôt : « Xavier Azalbert [peut] poursuivre la diffusion de fausses informations et de thèses complotistes avec l’aval de la CPPAP » (
8). Google, lui, se met à désindexer dès février 2021 des milliers d’articles de FranceSoir.fr de son moteur de recherche, puis supprime en mars sa chaîne YouTube, avant d’empêcher le journal en ligne d’accéder à la plateforme publicitaire Google Ads. FranceSoir porte plainte contre le géant du Net – qu’il accuse de censure – devant le tribunal de commerce de Paris, mais l’éditeur sera débouté en septembre 2022, jugement dont il a fait appel (
9).
Alors que le certificat de service de presse en ligne de FranceSoir doit arriver à échéance en septembre 2022 également, Xavier Azalbert avait déposé sa demande de renouvellement auprès de la CPPAP qui lui en accusera bonne réception le 22 juillet 2022. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d’Etat – Laurence Franceschini (photo ci-contre) depuis février 2017 – et son secrétariat est assuré par la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), la tête de pont du gouvernement au sein du ministère de la Culture. « C’est par voie de presse le 30 novembre 2022 que la rédaction de FranceSoir a appris la décision du ministère de la Culture de ne pas renouveler l’agrément CPPAP du journal, et plus particulièrement son certificat d’IPG. Selon la CPPAP, FranceSoir présenterait un “un défaut d’intérêt général” et nos contenus publiés à propos de la crise du Covid-19 porteraient “atteinte à la protection de la santé publique”», s’est alors étonné le directeur de la publication, Xavier Azalbert, le 2 décembre dernier (
10). La décision de la CPPAP de ne pas renouveler le certificat de service de presse en ligne de FranceSoir, qu’elle lui avait pourtant maintenu en mars 2021, est prise – après avis du ministère de la Santé (
11) – lors d’une séance le matin du 30 novembre 2022. « La CPPAP supprime (enfin) l’agrément de FranceSoir.fr», se réjouit le SNJ. FranceSoir – via sa maison mère la société Shopper Union France – fait appel le 22 décembre 2022 de cette décision datée officiellement du 5 décembre en demandant en référé sa suspension. L’éditeur s’inquiète de« l’interférence du gouvernement dans cette décision de la CPPAP » (
12) et dénonce en référé le fait qu’elle « méconnaisse la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de pluralisme des médias, le principe d’égalité, la garantie des droits, la séparation des pouvoirs ». Censure d’Etat ?
La société Shopper Union France demande en outre au tribunal administratif de Paris – par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 – de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur « la licéité de l’existence de la CPPAP en tant qu’instance chargée de garantir le pluralisme des médias (
13) alors qu’elle est rattachée au ministère de la Culture et ipso facto au gouvernement » (
14). A la suite d’une audience qui s’est tenue le 6 janvier dernier, le tribunal administratif de Paris rend une ordonnance le 13 janvier 2023 qui suspend l’exécution de la décision de la CPPAP et enjoint cette dernière de rétablir le régime d’aide dont bénéficiait FranceSoir.fr jusqu’alors. L’intervention de l’Association de la presse française libre (APFL), qui permet depuis 2020 de défiscaliser des dons faits à des titres de presse (la plupart d’extrême-droite), dont FranceSoir, a été jugé recevable. Quant à la QPC posant « la question de la licéité, de l’existence même de la CPPAP » (
15), elle a été transmise au Conseil d’Etat (
16). La société Shopper Union France pointe, par ailleurs, le fait que la conseillère d’Etat et présidente de la CPPAP, Laurence Franceschini, « a pris publiquement parti quant à la sanction qu’elle souhaitait infliger à FranceSoir» (
17) lors d’une audition de la commission Bronner qui a remis le 11 janvier 2022 à Emmanuel Macron à L’Elysée (
18), soit près d’un an avant la sanction, son rapport intitulé « Les lumières à l’ère du numérique ». La présidente de la CPPAP déclarait : « S’agissant en particulier du cas de FranceSoir, le seul levier dont dispose la commission serait de considérer que le site présente un “défaut d’intérêt général” en raison notamment d’allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique » (
19).
La CPPAP est-elle partiale, voire illicite ?
La CPPAP n’aurait pas statué en toute impartialité lors de sa séance du 30 novembre 2022. Plus de dix mois avant l’examen du dossier, la conseillère d’Etat Laurence Franceschini « a pu laisser à penser qu’en cas d’examen ultérieur de la situation de ce service de presse en ligne, retient le juge des référés Jean-Pierre Ladreyt, la [CPPAP] serait susceptible de retenir ce motif pour justifier le non-renouvellement de l’agrément dont il bénéficiait ». La balle est maintenant dans le camp du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel.
@ Charles de Laubier



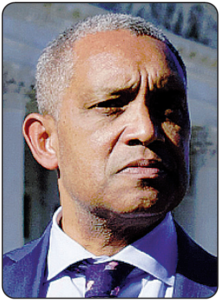 Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (
Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (