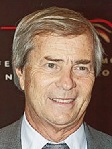Emmanuel Macron aurait bien voulu la nommer en janvier dernier présidente du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), mais Frédérique Bredin – dont le deuxième mandat à la tête du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) s’achève fin juin – lui aurait signifié qu’elle préférait en briguer un troisième.
 La présidence du CNC n’est pas à prendre, bien que très convoitée. Frédérique Bredin (photo) a déjà fait savoir qu’elle comptait rempiler pour un troisième mandat de trois ans – jusqu’en juillet 2022. Alors que le 72e Festival de Cannes s’est achevé le 25 mai au bout de douze jours sous les projecteurs, avec en parallèle le Marché du Film qui a fêté cette année ses 60 ans, l’inspectrice générale des finances ne donne aucun signe de fin de règne.
La présidence du CNC n’est pas à prendre, bien que très convoitée. Frédérique Bredin (photo) a déjà fait savoir qu’elle comptait rempiler pour un troisième mandat de trois ans – jusqu’en juillet 2022. Alors que le 72e Festival de Cannes s’est achevé le 25 mai au bout de douze jours sous les projecteurs, avec en parallèle le Marché du Film qui a fêté cette année ses 60 ans, l’inspectrice générale des finances ne donne aucun signe de fin de règne.
Sur « la plage du CNC », celle du Gray d’Albion à Cannes où le grand argentier du cinéma français a organisé événements et rencontres durant cette grand-messe du 7e Art sur la Croisette, sa présidente s’est bien gardée d’évoquer son sort. « La reconduction de Frédérique Bredin à la présidence du CNC semble plausible », nous confie un professionnel du cinéma français alors présent à Cannes. Mais il faudra attendre courant juin l’arbitrage du président de la République – lequel nomme les président(e)s de cet établissement public administratif sur proposition du ministre de
la Culture (sa tutelle) – pour que son troisième mandat de trois ans soit confirmé. Nommée en juillet 2013 par François Hollande, qui l’avait renouvelée dans ses fonctions fin juin 2016, Frédérique Bredin (62 ans) devrait être reconduite d’ici fin
juin. Parce que féminine, la quinzième présidence du CNC le vaudrait bien ?