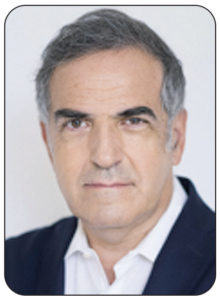Le projet de règlement européen sur les réseaux numériques – le Digital Networks Act (DNA) qu’avait initié en 2023 Thierry Breton lorsqu’il était commissaire européen au marché intérieur – est à l’agenda 2025 de la nouvelle Commission européenne. Henna Virkkunen reprend le flambeau.
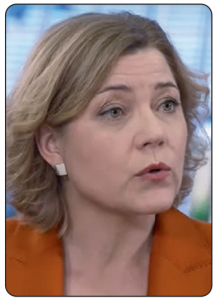 Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».
Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».
Le DNA sera présenté à partir d’octobre 2025
Si le Digital Networks Act (DNA) n’est ainsi mentionné qu’en sixième page du programme de travail de la Commission européenne pour 2025, adopté le 11 février (1), ce projet de règlement sur les réseaux numériques est bien parmi les priorités de la présidente Ursula von der Leyen, laquelle a entamé son second mandat « 2024-2029 » il y a maintenant trois mois. Dans les annexes de ce programme de travail des commissaires européens pour l’année en cours, ce futur texte législatif controversé apparaît bien dans la liste de travail mais pas sur fond bleu, couleur choisie par Bruxelles pour désigner justement les sujets contribuant aux nouveaux objectifs de « simplification » et de « réduction de la bureaucratie inutile » que recherche désormais Bruxelles pour « réduire les charges administratives et simplifier les règles de l’UE ». Dans ces annexes (2), l’on apprend que – à défaut d’être donc « simplificatrice » – cette future loi
(suite)
sur les réseaux numériques, « y compris l’évaluation d’impact », sera bien présentée cette année, au quatrième trimestre 2025.
Mais faire adopter ce DNA par le Parlement européen n’est pas gagné d’avance, en raison notamment d’une mesure controversée qui consisterait à instaurer une « contribution équitable » (network fees ou fair share). Celle-ci serait versée par les grandes plateformes numérique – les Gafam – aux opérateurs télécoms – les « telcos » – pour emprunter les réseaux de ces derniers. Les opposants à cette mesure craignent que cet « Internet à péage » ne remette en cause au passage le principe de neutralité d’Internet. Autre sujet sensible : l’harmonisation des fréquences mobiles afin de faciliter la création d’infrastructures paneuropéennes – notamment en prévision de la 6G. Bien que cet objectif ne soit pas explicitement fixé pour favoriser la consolidation des opérateurs télécoms, il pourrait y contribuer fortement, quitte à relancer le débat du passage de quatre à trois opérateurs mobiles dans chacun des Vingt-sept.
En tout cas, le DNA est bien à l’agenda 2025 d’Ursula von der Leyen (« UVDL ») qui l’a confirmé à sa vice-présidente Henna Virkkunen (photo), en charge de la souveraineté, sécurité et démocratie technologiques, dans sa lette de mission datée de septembre 2024 : « Je veux, a écrit l’Allemande UVDL à la Finlandaise Henna Virkkunen, que vous fassiez progresser les travaux de la Commission européenne pour améliorer l’accès à une connectivité sûre, rapide et fiable, dans le cadre d’une stratégie plus large pour l’informatique collaborative connectée. A cette fin, vous devriez travailler sur un nouveau règlement sur les réseaux numériques [“Digital Networks Act” dans le texte, ndlr] pour aider à stimuler le haut débit sécurisé, fixe et sans fil. Vous devrez encourager les investissements dans l’infrastructure numérique » (3).
Henna Virkkunen a déjà fait sienne le DNA lancé par Thierry Breton. La présidente de la Commission eurpéenne n’exclut pas une redevance payée par les Gafam aux « telcos » et se dit favorable à la consolidation des opérateurs télécoms en Europe. Dans ses réponses de novembre 2024 au Parlement européen, où elle a été auditionnée pour que sa nomination soit approuvée par les eurodéputés (4), elle n’a pas éludé la question : « Il y a un nombre croissant d’acteurs dans l’économie des réseaux et un débat animé. Ce débat ne devrait pas se réduire à une simple discussion sur les redevances de réseau. Il devrait s’agir de la façon dont les différents acteurs contribuent à un écosystème de communication dynamique et novateur, basé sur des règles du jeu équitables ».
Rapports Letta et Draghi, et « livre blanc »
Sur la perspective d’une éventuelle consolidation des opérateurs télécoms en Europe, Henna Virkkunen a aussi prévenu les eurodéputés, sans pour autant prononcer le mot qui fâche de « consolidation » : « Nous devons encourager les investissements dans les infrastructures numériques et achever le marché unique. Cela placera l’Europe à l’avant-garde de la prochaine génération d’infrastructures numériques, sûres et intelligentes, y compris la 6G, dans le cadre de la transformation industrielle propre ». Elle se réfère pour y parvenir aux rapports Letta (5) et Draghi (6) remis à UVDL respectivement en avril 2024 et en septembre 2024, le premier sur « l’avenir du marché unique » (7), le second sur « l’avenir de la compétitivité globale de l’UE » (8). Ces deux rapports préconisent la consolidation des opérateurs télécoms « pour obtenir des taux d’investissement plus élevés en matière de connectivité » et « afin de créer un véritable marché unique » (rapport Draghi), ou encore « pour réaliser des économies d’échelle » et « réduire les coûts et favoriser l’innovation » (rapport Letta). Cela va justement dans le sens des opérateurs télécoms historiques européens qui appellent de leurs vœux – via notamment l’Etno (9), leur lobby bruxellois – cette consolidation. En France, le débat d’un passage à trois opérateurs télécoms au lieu de quatre perdure depuis des années, avec Orange et SFR (Altice) qui en rêvent (10).
 Le livre blanc « télécoms » approuvé fin 2024
Le livre blanc « télécoms » approuvé fin 2024
Un pas décisif a été franchi le 6 décembre 2024, lors du Conseil européen des télécoms qui a réuni les ministres concernés des Vingt-sept, lesquels ont approuvé le livre blanc de la Commission européenne intitulé « Comment maîtriser les besoins de l’Europe en matière d’infrastructures numériques ? ». Dans ses conclusions (11), le Conseil européen ouvre officiellement mais prudemment la voie à la consolidation des opérateurs télécoms : « Une consolidation autorisée induite par le marché pourrait, à condition qu’il y ait une concurrence effective sur le marché concerné, créer des économies d’échelle au niveau des réseaux de communications électroniques dans l’UE et ouvrir ainsi de nouvelles possibilités aux acteurs du marché ».
Tout en mettant en garde : « La consolidation devrait être évaluée par les autorités compétentes en tenant compte de son incidence potentielle sur le maintien et le développement d’une concurrence effective sur le marché concerné ». Pour justifier la perspective d’une consolidation du marché européen des télécoms, la Commission « von der Leyen I » (photo ci-dessus) dressait dans le livre blanc proprement dit (12), présenté le 21 février 2024, le panorama suivant : « Alors que l’UE compte une cinquantaine d’opérateurs de réseau mobile et plus d’une centaine d’opérateurs de réseau fixe, seuls quelques opérateurs européens (Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Iliad et Telefónica, par exemple) sont présents sur plusieurs marchés nationaux. S’agissant des marchés de la téléphonie mobile, considérés du point de vue des services, seize Etats membres ont trois opérateurs de réseaux mobiles ; neuf en ont quatre, et deux en ont cinq ». Ce livre blanc « Infrastructures numériques » souligne en outre que « les prix du haut débit mobile et fixe sont généralement plus bas dans l’UE qu’aux Etats-Unis pour la grande majorité des tarifs, ce qui apporte d’importants avantages à court terme aux consommateurs ». Faut-il pour autant mettre un terme à cette avancée en réduisant le nombre d’opérateurs télécoms dans chaque Etat membre ? La Commission européenne se garde bien de répondre à cette question.
Concernant cette fois le projet de « contribution équitable » évoquée pour la première fois par la Commission européenne il y a deux ans, dans sa « consultation exploratoire sur l’avenir du secteur des communications électroniques et de ses infrastructures » (13), ni le livre blanc de la Commission européenne ni les conclusions du Conseil européen sur le même livre blanc ne parlent de cette hypothèse – trop sensible – de network fees (ou de fair share). Les résultats de la consultation exploratoire, publiés le 10 octobre 2023 (14)), confirme cependant que certains acteurs – sans citer d’opérateurs télécoms – souhaitent cette « taxe » auxquels les Gafam seraient soumis au profit des « telcos », ne serait-ce que pour financer l’« obligation de service universel » (OSU) : « Ceux qui ont suggéré d’élargir la portée des sources de financement, ont indiqué qu’une contribution équitable d’un plus grand nombre de fournisseurs assurerait de meilleurs services aux consommateurs. Ils ont fait valoir que les entités bénéficiant d’un accès au réseau devraient supporter les coûts de son développement et que les contributions pourraient être calculées sur la base de critères définis et proportionnés, par exemple la taille et le chiffre d’affaires de l’opérateur, le trafic généré, etc. ». Le financement du service universel (OSU), laquelle vise à garantir que le secteur public fournisse le téléphone et l’accès haut débit à Internet à tous les consommateurs européens et à un prix abordable, cristallise donc le débat autour de cette « contribution équitable ».
Une « taxe Gafam » pour le service universel ?
A la consultation de 2023, les répondants sont partagés : « Certains ont indiqué que l’OSU [obligation de service universel] devrait continuer à être financée par le budget général des pouvoirs publics [l’Etat, ndlr], tandis que d’autres ont estimé que l’OSU devrait être financée par les fournisseurs d’ECN [electronic communication networks, ou « telcos », ndlr] ». Voire par les Gafam qui utilisent les réseaux… Or, est-il rapporté, « un fournisseur de contenu a fait remarquer que les contributions directes à l’OSU de son secteur seraient préjudiciables aux investissements dans la production de contenu ». @
Charles de Laubier

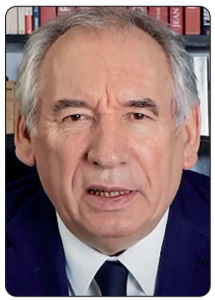 « La réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme », a lancé François Bayrou (photo), l’actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale prononcée le 14 janvier devant l’Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le maire de Pau n’en a rien dit de plus. Ayant obtenu ce feu vert qu’elle attendait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné le coup d’envoi de la réforme lors de ses vœux le 27 janvier : « La gouvernance de notre audiovisuel public doit évoluer […]. Je mènerai ce projet à son terme d’ici l’été ».
« La réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme », a lancé François Bayrou (photo), l’actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale prononcée le 14 janvier devant l’Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le maire de Pau n’en a rien dit de plus. Ayant obtenu ce feu vert qu’elle attendait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné le coup d’envoi de la réforme lors de ses vœux le 27 janvier : « La gouvernance de notre audiovisuel public doit évoluer […]. Je mènerai ce projet à son terme d’ici l’été ». France Médias, « une usine à gaz » ?
France Médias, « une usine à gaz » ?  Ursula von der Leyen entame depuis le 1er décembre son second mandat de cinq ans (2024-2029) à la présidence de la Commission européenne, dont le collège composé de vingt-sept membres – y compris elle-même (
Ursula von der Leyen entame depuis le 1er décembre son second mandat de cinq ans (2024-2029) à la présidence de la Commission européenne, dont le collège composé de vingt-sept membres – y compris elle-même (