C’est une polémique dont se serait bien passé l’ancien président de Radio France, Mathieu Gallet, pour le lancement le 4 juin de sa plateforme de podcasts Majelan. Surtout qu’il s’oppose à sa successeure à Radio France, Sibyle Veil,
vent debout contre la reprise des podcasts gratuits du groupe public.
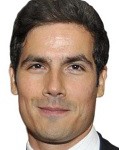
 « Contrairement aux services de VOD, les podcasts ne sont pas aujourd’hui dans le champ de la régulation audiovisuelle. Donc pas de possibilité de saisine du CSA en règlement des différends », indique Nicolas Curien, membre du CSA à Edition Multimédi@. A Mathieu Gallet (photo de gauche) qui estime pouvoir reprendre les podcasts gratuits de Radio France – déjà disponibles librement sur Internet via des flux de syndication publics dits RSS (1) – et les proposer à son tour gratuitement sur sa plateforme Majelan, Sibyle Veil (photo de droite) a fait savoir le 6 juin sur France Inter qu’elle s’y opposait.
« Contrairement aux services de VOD, les podcasts ne sont pas aujourd’hui dans le champ de la régulation audiovisuelle. Donc pas de possibilité de saisine du CSA en règlement des différends », indique Nicolas Curien, membre du CSA à Edition Multimédi@. A Mathieu Gallet (photo de gauche) qui estime pouvoir reprendre les podcasts gratuits de Radio France – déjà disponibles librement sur Internet via des flux de syndication publics dits RSS (1) – et les proposer à son tour gratuitement sur sa plateforme Majelan, Sibyle Veil (photo de droite) a fait savoir le 6 juin sur France Inter qu’elle s’y opposait.



