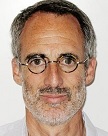Opération « mains propres » sur le marché français de la publicité numérique : maintenant que le décret « Reporting » a enfin été publié – le 11 février – à la grande satisfaction des annonceurs, le plus dur reste à faire pour savoir qui
rend compte à qui, tant les intermédiaires sont nombreux.
 Publicité sur Internet, publicité programmatique, enchères publicitaires, achats publicitaires en temps réel, … Jamais le marché de la publicité n’a été aussi complexe et les relations entre annonceurs, agences conseil, régies, intermédiaires techniques et médias, aussi opaques. Commissions cachées, comptes-rendus absents, transactions occultes, prestations floues, modifications unilatérales, … La loi « Sapin » de 1993 sur « la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique » impose bien des obligations de reporting clairs dans les contrats classiques signés de gré à gré dans la publicité, mais elles ne s’appliquent toujours pas à la publicité numérique souvent automatisée.
Publicité sur Internet, publicité programmatique, enchères publicitaires, achats publicitaires en temps réel, … Jamais le marché de la publicité n’a été aussi complexe et les relations entre annonceurs, agences conseil, régies, intermédiaires techniques et médias, aussi opaques. Commissions cachées, comptes-rendus absents, transactions occultes, prestations floues, modifications unilatérales, … La loi « Sapin » de 1993 sur « la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique » impose bien des obligations de reporting clairs dans les contrats classiques signés de gré à gré dans la publicité, mais elles ne s’appliquent toujours pas à la publicité numérique souvent automatisée.