Après l’allemand Nextcloud, membre d’Euclidia, c’est au tour du français OVH, dont un dirigeant préside le Cispe, de faire savoir qu’il a aussi déposé plainte en 2021 auprès de la Commission européenne contre Microsoft accusé de favoriser ses services sur son cloud Azure. Margrethe Vestager va-t-elle lancer une enquête ?
 Le groupe français OVH a porté plainte auprès de la direction générale de la concurrence (DG Competition) de la Commission européenne contre l’américain Microsoft pour abus de position dominante avec son service de cloud Azur. C’est ce qu’a révélé le 16 mars le Wall Street Journal (1), information confirmée le même jour, notamment auprès d’Euractiv (2). Le français du cloud n’est pas le seul à accuser la firme de Redmond de favoriser ses propres logiciels, dont la suite Office, dans son infrastructure nuagique Azur et de ne pas les rendre optimaux sur des plateformes de cloud concurrentes.
Le groupe français OVH a porté plainte auprès de la direction générale de la concurrence (DG Competition) de la Commission européenne contre l’américain Microsoft pour abus de position dominante avec son service de cloud Azur. C’est ce qu’a révélé le 16 mars le Wall Street Journal (1), information confirmée le même jour, notamment auprès d’Euractiv (2). Le français du cloud n’est pas le seul à accuser la firme de Redmond de favoriser ses propres logiciels, dont la suite Office, dans son infrastructure nuagique Azur et de ne pas les rendre optimaux sur des plateformes de cloud concurrentes.
Selon les constations de Edition Multimédi@, OVH – société fondée en 1999 à Roubaix, dans le Nord de la France, par Octave Klaba (photo de gauche), son actuel président et principal actionnaire – est membre fondateur de l’association des fournisseurs de services d’infrastructure cloud en Europe (Cispe), où l’on retrouve parmi ses vingt-cinq membres le géant Amazon Web Service (AWS), le français Outscale (Dassault Systèmes), le finlandais UpCloud, le néerlandais Altus Host, l’italien Aruba.it ou encore l’espagnol Gigas. Cette coalition Cispe est présidée depuis sa création en octobre 2016 par Alban Schmutz, vice-président d’OVH en charge du développement et des affaires publiques. Elle est aussi par ailleurs membre fondateur de GaiaX, le cloud souverain européen.
Porter plainte présente des risques de représailles
Pour autant, ni le Wall Street Journal ni Euractiv ne mentionnent l’exitence de ce lobby Cispe, basé à Bruxelles, lequel prend acte le 17 mars des révélations du quotidien économique et financier américain concernant la plainte d’OVH mais, curieusement, sans nommer OVH ni dire qu’il est l’un des membres fondateurs de Cispe et qu’Alban Schmutz en est le président depuis près de six ans. De plus, la plainte d’OVH auprès de la Commission européenne remonte à l’été 2021 et n’est révélée que mi-mars et elle n’est pas la seule à avoir été déposée contre Microsoft car d’autres prestataires de cloud européens – dont les noms ne sont pas dévoilés – l’on fait de leur côté. Pourquoi tant de discrétion ? « Le communiqué du 17 mars ne mentionne aucun membre. OVHcloud, un des plaignants dans l’action en concurrence intentée à l’égard de Microsoft, est effectivement membre de notre organisation. Quant aux autre membres fournisseurs d’infrastructure en nuage européens qui auraient aussi déposé plainte, ils ont dû faire une demande express à la Commission européenne pour ne pas être cités. Du coup, il ne nous est pas possible de dévoiler leur identité. La crainte de représailles commerciales – à leur égard ou à l’encontre de leurs clients – semble être la raison motivant cette demande », nous a répondu le secrétaire exécutif du Cispe, Francisco Mingorance.
Microsoft, mais aussi Oracle et SAP
Des nuages noirs se forment et menacent le marché du cloud en Europe. « Il y a une tempête qui se prépare depuis un certain temps sur l’utilisation injuste des licences de logiciels par certains éditeurs de logiciels historiques pour contrôler le marché de l’infrastructure cloud. (…) Des recherches menées par des experts renommés, les professeurs Jenny (3) et Metzger (4), ont également mis en évidence la façon dont les sociétés de logiciels historiques, dont Microsoft, utilisent des conditions injustes pour restreindre le choix et augmenter les coûts, ce qui nuit aux clients et menace les propres fournisseurs d’infrastructures de cloud en Europe », a déclaré la coalition Cispe (5). Celle-ci a adressé le 7 février dernier à la vice-présidente de la Commission européenne en charge notamment du numérique, Margrethe Vestager, une lettre ouverte intitulée « Pourquoi le DMA [le Digital Markets Act, dont les négociations ont abouti le 24 mars, ndlr] ne protège pas (encore) le marché du cloud de l’UE ». La quarantaine de signataires tirent la sonnette d’alarme : « Sans clarification dans la DMA, il en résultera la poursuite des pratiques déloyales des contrôleurs de logiciels monopolistiques [monopoly software gatekeepers, dans le texte en anglais], y compris Microsoft, Oracle et SAP » (6).
Dans son communiqué du 17 mars, le Cispe souligne le fait que la plainte d’OVH est la troisième contre Microsoft à se faire connaître en dix-huit mois et la deuxième en un an, mais n’en cite aucun. Pourtant, outre le français OVH, l’un des deux autres plaignants ayant attaqué Microsoft s’est déjà fait connaître publiquement l’an dernier. Il s’agit Nextcloud. Dans une déclaration fin novembre 2021, ce prestataire de cloud allemand, basé à Stuttgart, a annoncé avoir été rejoint par « une coalition d’entreprises européennes de logiciels et de cloud » pour porter plainte formellement devant la Commission européenne afin de dénoncer « le comportement anticoncurrentiel de Microsoft en ce qui concerne son offre OneDrive (cloud) » et le fait que «Microsoft regroupe ses OneDrive, Teams et autres services avec Windows et pousse de façon agressive les consommateurs à s’inscrire et de remettre leurs données à Microsoft ». Résultat de cette pratique dite de self-preferencing : « Cela limite le choix des consommateurs et crée un obstacle pour les autres entreprises qui offrent des services concurrents » (7), s’insurgent les plaignants de cette « coalition pour un terrain de jeu équitable » emmenés par Nextcloud. Près d’une trentaine d’entreprises (8) ont répondu à l’appel de ce dernier, parmi lesquelles le français Linagora. Contacté par Edition Multimédi@, le PDG fondateur de Nextcloud, Frank Karlitschek (photo de droite), a confirmé que son entreprise fait par ailleurs partie d’une association différente de Cispe : « Nous sommes membre d’Euclidia (European Cloud Industrial Alliance), ainsi que de GaiaX et de l’Open Forum Europe. Quant à la plainte de la coalition, elle progresse bien. Il y aura des nouvelles bientôt ». Est-ce à dire que Margrethe Vestager va lancer prochainement une enquête autour des pratiques dans le cloud, notamment de la part de Microsoft ? « Je ne peux pas le confirmer malheureusement », nous a-t-il répondu.
Nextcloud, qui offre une plateforme de collaboration basée sur du logiciel libre et utilisant des solutions grand public comme Dropbox et Google Drive, s’inquiète des agissements de Microsoft dans le cloud qui rappellent l’éviction de la concurrence dans les années 2000 des navigateurs web concurrents d’Internet Explorer. « Nous demandons aux autorités antitrust en Europe de faire en sorte que les règles du jeu soient équitables, de donner aux clients le libre choix et de donner une chance équitable à la concurrence », exhorte la coalition menée par Nextcloud qui a déposé une plainte auprès de la DG Concurrence et « discute d’une plainte en France avec ses membres de la coalition ». Ce n’est donc pas un hasard si, en janvier 2022, l’Autorité de la concurrence s’est auto-saisie (9). Début 2021, l’entreprise de Frank Karlitschek avait également déposé auprès de l’autorité antitrust allemande, le Bundeskartellamt, une demande d’enquête contre Microsoft. Google et Amazon concernés eux aussi L’alliance Euclidia, basée à Bruxelles et réunissant une trentaine d’organisations (10), fait partie – avec European Digital SME Alliance (11), The Document Foundation (12), la Free Software Foundation Europe (13) – de la coalition ralliée à Nextcloud. « Euclidia soutient l’action en justice de Nextcloud pour mettre fin au comportement anticoncurrentiel de Microsoft sur le marché européen, et appelle à mettre fin à des comportements similaires par d’autres acteurs prédateurs comme Google et Amazon », avait déclaré le 26 novembre 2021 cette alliance, en mentionnant bien l’un de ses membres (Nextcloud) à l’origine de la plainte – contrairement au Cispe qui a tu le nom d’OVH. @
Charles de Laubier


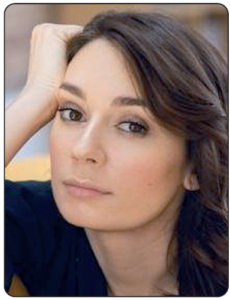
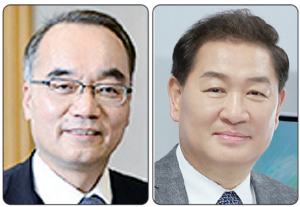 Le Mobile World Congress (MWC) est de retour à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Après deux années impactées par la pandémie, notamment par l’annulation de l’édition de 2020 (
Le Mobile World Congress (MWC) est de retour à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Après deux années impactées par la pandémie, notamment par l’annulation de l’édition de 2020 (


